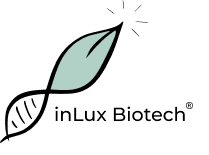Du modèle chimique à la protection combinatoire : une évolution nécessaire
Pendant des décennies, l’agriculture européenne a reposé sur une logique de lutte chimique exclusive : pulvérisation de molécules de synthèse à fortes doses, répétées sur la saison, et application préventive même en l’absence de risque immédiat.
Ce modèle a permis des gains rapides de rendement, mais il montre aujourd’hui ses limites : pollution des sols et des nappes phréatiques (1), altération de la biodiversité utile (2), risques sanitaires (3) et surtout apparition rapide de résistances chez les bioagresseurs (4).
Ces constats sont renforcés par les données issues de la recherche agronomique : l’usage continu d’un même mode d’action chimique exerce une pression de sélection qui favorise l’émergence de souches résistantes de champignons, insectes ou adventices (5). C’est sur ce point que le concept de protection combinatoire s’impose : associer différentes stratégies (biosolutions, technologies de suivi, chimie raisonnée) pour rompre le cycle des résistances et réduire l’empreinte environnementale.
Les biosolutions, qu’il s’agisse de biocontrôle, de biostimulants ou de biofertilisants, issues de micro-organismes bénéfiques, d’extraits naturels ou de substances minérales, s’intègrent dans cette logique. Elles agissent par stimulation des défenses naturelles des plantes, modification de la flore microbienne ou régulation ciblée des populations de ravageurs (6).
Les politiques publiques, du Pacte Vert (Green Deal) à la stratégie « Farm to Fork », poussent à réduire de 50 % l’usage des pesticides d’ici 2030 en misant sur ces approches intégrées (8).
Les biosolutions et les pesticides dans une logique synergique
Les biosolutions, piliers de la protection intégrée
Les études montrent que les biosolutions sont d’autant plus performantes qu’elles sont intégrées dans un programme complet de gestion intégrée des cultures (9). Le biocontrôle repose sur des agents vivants (champignons antagonistes, bactéries, virus entomopathogènes) ou des substances naturelles qui agissent par compétition, prédation ou induction de résistances (10).
Les biostimulants soutiennent la tolérance aux stress abiotiques (sécheresse, salinité) et améliorent la physiologie de la plante sans effet direct sur les ravageurs (11). Les biofertilisants optimisent la nutrition et participent à la structuration du sol (12).
Il est possible de faire progresser rapidement la validation scientifique de ces modes d’action grâce aux outils d’imagerie dynamique in planta, et acquérir des connaissances sur les conditions optimales de déclenchement du traitement.
Synergies et complémentarité : la clé d’une protection durable
La stratégie combinatoire ne consiste pas simplement à juxtaposer pesticides et biosolutions, mais à organiser leur utilisation selon un calendrier raisonné, où chaque intervention est positionnée à un stade clé. Les pesticides chimiques sont réservés aux périodes de risque maximal, alors que les biosolutions assurent un fond de protection biologique et physiologique tout au long du cycle (13).
Ce mode d’action multi-cibles retarde la perte d’efficacité des molécules chimiques (14), tout en réduisant les quantités appliquées.

Des essais en serre et au champ montrent qu’une alternance judicieuse réduit les Indicateurs de Fréquence de Traitement (IFT) de 30 à 50 % sans perte de rendement (15).
Des outils numériques permettent aujourd’hui d’ajuster à la parcelle les programmes combinatoires : modélisation de la pression parasitaire, suivi en temps réel de biomarqueurs lumineux, prévision des stades critiques (16). Cette personnalisation favorise à la fois l’efficacité des biosolutions et la diminution du recours aux intrants chimiques.

Applications concrètes et perspectives pour la filière agricole
En grandes cultures, un itinéraire combinatoire peut par exemple démarrer par l’apport de biofertilisants microbiens pour améliorer l’absorption des nutriments, suivi d’un biostimulant en pré-floraison pour préparer la plante aux stress, puis d’agents de biocontrôle lors des premières détections de pathogènes (17).
En viticulture, cette logique trouve une application exemplaire : utilisation de phéromones pour confusion sexuelle, de microorganismes antagonistes dès le début de saison, et de produits chimiques uniquement lors de signaux d’alerte forts détectés par les capteurs in planta, comme pour anticiper un épisode de mildiou (18).
Les perspectives sont prometteuses : la combinaison de la recherche en microbiologie appliquée, de la phénotypage dynamique et de l’encadrement réglementaire devrait accélérer l’adoption de ces pratiques (19).
Sources
(1) Jacquet F, Butault JP, Guichard L. An overview of pesticide use in Europe: drivers, current trends and future prospects in a context of sustainable development. Environ Sci Policy. 2011;14(8):882-892.
(2) Geiger F, et al. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland. Basic Appl Ecol. 2010;11(2):97-105.
(3) Mostafalou S, Abdollahi M. Pesticides: an update of human exposure and toxicity. Arch Toxicol. 2017;91(2):549-599.
(4) Heap I. Global perspective of herbicide-resistant weeds. Pest Manag Sci. 2014;70(9):1306-1315.
(5) Savary S, et al. The global burden of pathogens and pests on major food crops. Nat Ecol Evol. 2019;3:430–439.
(6) Behl RK, Sharma H, Singh KP. Microbial biosolutions for improving crop productivity: Recent advances and future directions. Indian J Microbiol. 2019;59(2):125-139.
(7) Broeckx T, et al. Plant bioluminescence imaging: Emerging technologies and applications in plant biology. Plant Methods. 2021;17:87.
(8) European Commission. Farm to Fork Strategy. Brussels: EC; 2020.
(9) Glare TR, et al. Have biopesticides come of age? Trends Biotechnol. 2012;30(5):250-258.
(10) Choudhary DK, Johri BN. Interactions of Bacillus spp. and plants – With special reference to induced systemic resistance. Microbiol Res. 2009;164(5):493–513.
(11) Calvo P, Nelson L, Kloepper JW. Agricultural uses of plant biostimulants. Plant Soil. 2014;383:3–41.
(12) Mendes R, et al. The rhizosphere microbiome: significance of plant beneficial, plant pathogenic, and human pathogenic microorganisms. FEMS Microbiol Rev. 2013;37(5):634–663.
(13) Pretty J, Bharucha ZP. Sustainable intensification of agriculture: greener approaches and strategies. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2014;369(1639):20120261.
(14) Stenberg JA, Sundh I, Becher PG, et al. Integrated pest management: from chemical control to biosolutions. Front Ecol Evol. 2019;7:105.
(15) Schmid F, Mauch-Mani B. Disease management in viticulture: role of combined strategies and imaging technologies. J Plant Prot Res. 2022;62(4):364–387.
(16) Li L, et al. Integrating phenotyping and imaging technology for precision crop management. Front Plant Sci. 2021;12:609786.
(17) Giagnoni L, et al. Activating plant-microbe interactions for ecological intensification: practical cases. Ecol Indic. 2018;90:520–531.
(18) Tzeng KC, et al. Modeling light signals in bioluminescent plants to predict resistance and disease progression. Sensors. 2023;23(1):499.
(19) El-Sayed AS, et al. Validation of plant biosolution performance using bioluminescence and molecular markers. Biotechnol Rep. 2022;36:e00712.